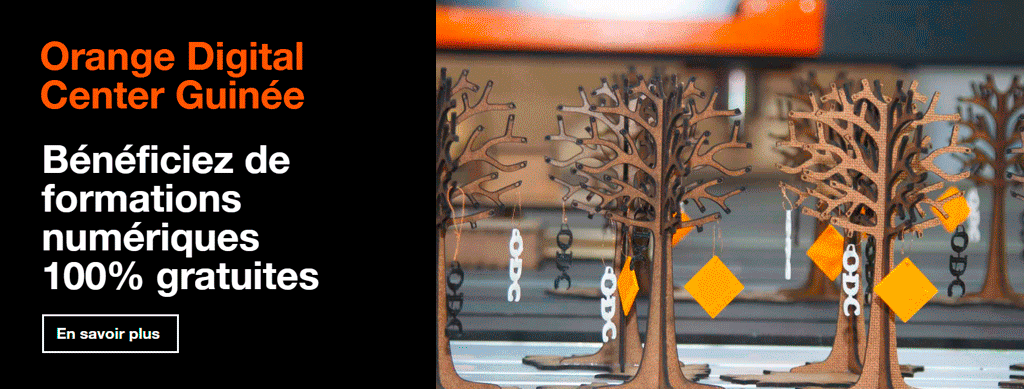La chute d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) déposé le 18 août par un coup d’État militaire parachève l’échec de la communauté internationale au Mali, et en premier lieu celui de la France. Privilégiant l’approche sécuritaire via la force Barkhane, elle n’a pas tenu compte des mises en garde sur la gouvernance laxiste d’IBK et sa réélection douteuse en 2018.
« À crise multidimensionnelle, échec multidimensionnel », ironise le chercheur Mathieu Pellerin, spécialiste du Sahel. Rarement un pays aura été autant soutenu que le Mali ces dernières années, tant au niveau financier que sur le plan sécuritaire. L’ONU y a envoyé plus de 13 000 Casques bleus, la France y compte l’essentiel des 5 100 soldats de la force Barkhane et l’Union européenne y a mis en place une « Mission de formation de l’Union européenne au Mali » (EUTM) qui aura vu passer, durant six ans, près de 14 000 militaires maliens, soit une grande partie de l’armée. Malgré tout, le Mali est encore ravagé par une guerre multiforme opposant groupes djihadistes, milices d’autodéfense, mouvements rebelles et forces régulières, qui fait des milliers de victimes chaque année, et sa gouvernance est affublée des mêmes tares que sous la présidence d’Amadou Toumani Touré (2002-2012) : gabegie, corruption, clientélisme…
LE REJET DES POLITICIENS
La classe politique malienne est en grande partie responsable de ce fiasco. Enfermée depuis trois décennies dans un système d’affinités qui, sous couvert de consensus, a permis à une petite élite d’accaparer les richesses du pays, elle s’est montrée incapable de répondre aux attentes des Maliens. La popularité de l’imam Mahmoud Dicko, qui a contribué à la chute du président en multipliant les appels à sa démission ces derniers mois, et l’accueil réservé aux putschistes par des milliers de manifestants à Bamako les jours qui ont suivi le coup d’État illustrent le rejet des politiciens. « Les évènements du 18 août semblent ramener le Mali au point de départ de la crise de mars 2012, constate l’International Crisis Group. À l’époque, des militaires avaient renversé le président Touré, ouvrant une période de troubles politiques alors qu’une crise sécuritaire secouait le nord du pays. La leçon est sans appel : les huit ans qui se sont écoulés depuis ont largement été gaspillés, et le surplace politique s’est révélé coûteux ».
Mais si échec il y a, c’est aussi celui de la France. « Ici, c’est elle, parmi les principaux partenaires du Mali, qui détient le leadership, constate un fonctionnaire européen basé à Bamako. Les États membres de l’Union européenne dépendent en grande partie de son bon vouloir, et ils se calent plus ou moins sur les priorités fixées à Paris. » Certes, en envoyant ses troupes pour contrer l’avancée des djihadistes en janvier 2013, et en mettant ainsi un frein à la partition du Mali et aux ambitions des groupes liés à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Paris peut se targuer — et ne s’en prive d’ailleurs pas, même si le terme reste contestable — d’avoir « sauvé » le Mali. Sur le plan opérationnel, cette opération Serval a été un succès salué jusqu’à Washington. Mais le bilan de ce qui a suivi est bien moins reluisant. Et les bons connaisseurs du Sahel n’avaient pas attendu le putsch du 18 août pour critiquer le soutien sinon aveugle, du moins complice apporté publiquement par la France à IBK pendant sept ans.
Dès que l’opération Serval est déclenchée, en janvier 2013, Paris fixe une priorité au président par intérim Dioncounda Traoré : organiser au plus vite l’élection présidentielle. Pour mener ses opérations militaires, la France estime qu’elle a besoin d’un gouvernement légitime sur lequel elle pourra compter, ce qui n’est pas le cas du gouvernement de transition issu du coup d’État de mars 2012. Traoré est fragilisé par les ambitions des membres de la junte, ainsi que par l’occupation du nord du pays par les djihadistes. Son pouvoir ne tient qu’à un fil. Avec l’intervention de la France, il est devenu son obligé par la force des choses. Il se met donc à la tâche, sous la pression constante du président François Hollande, de Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, qui fixent une date butoir : le 31 juillet 2013.
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À TOUT PRIX
À l’origine, la feuille de route prévoyait l’élection en décembre. Mais, face à ses pairs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Traoré plaide pour juillet. Le premier tour aura finalement lieu le 28 juillet, en dépit d’une situation sécuritaire instable et du scepticisme de nombreux observateurs.
« Organiser des élections pour sortir des crises politiques, des conflits violents, des périodes de transition après un coup d’État, c’est une recette que l’on aime bien. Elle a généralement l’assentiment et même la préférence des partenaires extérieurs les plus influents à la recherche d’interlocuteurs qui seraient légitimes parce que démocratiquement élus. On attend ensuite que des miracles se produisent, que la gouvernance politique et économique change après une élection, quel que soit le président élu, quelle que soit la qualité du processus électoral et quelle que soit la vacuité du débat politique pré-électoral », notait récemment l’analyste politique Gilles Olakounlé Yabi, fondateur de Wathi, un think tank citoyen. Qui concluait, en pensant peut-être à l’élection menée au forceps de 2013 : « Si une transition focalisée sur l’organisation rapide d’élections permettait d’enclencher un processus crédible et durable dans ces deux directions, cela se saurait. »
Une fois la date fixée, la France choisit son favori parmi la pléthore de candidats (28). Il s’agit d’Ibrahim Boubacar Keïta, dit « IBK ». Ce socialiste formé à l’école française connaît Hollande depuis de nombreuses années. Tout au long de la campagne électorale, il a dit les mots que les Maliens voulaient entendre : « fierté », « unité », « patrie ». En prônant la fermeté face aux rebelles et aux militaires, il a aussi séduit la France et plus largement une bonne partie de la communauté internationale, qui voit en lui le « candidat de la stabilité ». Cela ne fait peut-être pas gagner une élection, mais cela permet de se forger une stature auprès de l’électorat. Les diplomates français en poste à Bamako à l’époque lui tressent des lauriers et admettent en off qu’il est le candidat de Paris. Ils n’entendent pas les Cassandre qui, bien loin de l’image d’homme à poigne qu’il cultive depuis des années, le décrivent comme un dilettante se rêvant en digne héritier d’une lignée de souverains mandingues.
UNE PRÉSIDENCE CORROMPUE
La suite leur donnera raison. Bien que largement élu à l’issue du second tour (77,6 % des suffrages), IBK sera incapable de donner un cap à son gouvernement. Même parmi ses collaborateurs, on admet que le plus important pour lui n’était pas de diriger, mais de trôner. Il laisse faire son entourage, composé en grande partie de sa famille. Très vite, les scandales financiers se multiplient : achat d’un avion présidentiel pour un montant de 40 millions de dollars (34 millions d’euros) jugé peu opportun en ces temps de crise, et négocié par l’intermédiaire d’un sulfureux homme d’affaires français, Michel Tomi ; suspicions de surfacturations dans un contrat colossal de matériel militaire (69 milliards de francs CFA, soit plus de 105 millions d’euros)… Tout le monde au Mali s’interroge sur les prix farfelus de certains équipements, comme ces chaussettes de soldats facturées 15 euros la paire. Ces deux transactions provoquent l’ire du FMI et de la Banque mondiale, qui suspendent un temps leur appui au pays.
Les scandales de ce genre se multiplieront au fil des ans, de même que les gouvernements : IBK a changé quatre fois de premier ministre en l’espace de quatre ans, sans que la France ne s’en offusque — du moins publiquement. Sous la présidence Hollande, il est intouchable. « On n’est pas dupe, on voit ce qu’il se passe, admettait à l’époque un diplomate français. Mais on ne peut pas le dire publiquement. IBK est un allié dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, vous mettez qui à la place ? » Son échec est pourtant frappant. Non seulement le nord du pays échappe toujours au contrôle des autorités étatiques, mais très vite, en 2015, le centre devient également un foyer de tensions. Les groupes djihadistes gagnent du terrain, et pour remédier à l’absence de l’armée, des milices d’autodéfense se constituent, le plus souvent sur la base de l’appartenance communautaire, et parfois avec le soutien des autorités. Les massacres de civils se multiplient, et sont parfois commis par les Forces armées maliennes (Fama).
À Bamako, la gouvernance suscite également des critiques. Les diplomates constatent que la gabegie et la corruption sont toujours très importantes, et que le clan familial tente de mettre la main sur la plupart des contrats publics. La France le sait, mais se tait. Même sa proximité avec Michel Tomi, un ami de longue date (« un frère », dit-il) qui est dans le viseur de la justice française et que les services de police présentent comme le dernier des parrains corses, ne lui porte pas préjudice. En juin 2014, Tomi, qui a fait fortune en Afrique dans les jeux d’argent et les courses hippiques, est mis en examen pour tout un tas d’infractions, dont « corruption d’agent public étranger ». Les juges se demandent pourquoi il s’est montré si généreux avec IBK, en vêtements de luxe, en chambres d’hôtels, de luxe toujours, ou encore en voyages en jets privés.
Quand arrive l’élection présidentielle de 2018, le bilan d’IBK est peu reluisant. Officiellement, la France n’a pas de candidat. Officieusement non plus. La donne a changé à Paris avec l’élection d’Emmanuel Macron un an plus tôt. « Très vite, le président est arrivé à la conclusion qu’IBK n’était pas fiable, qu’il avait une part de responsabilité dans la déliquescence de l’État, et qu’il serait incapable de mettre un frein à l’affairisme de son entourage », indique un diplomate français. Macron et son ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne comptent plus sur lui pour relever le pays. Mais ils ne pipent mot quand il est réélu à l’issue du second tour (avec 67,17 % des suffrages) dans des conditions très contestables, et avec un taux de participation minimal (34,54 %). À l’instar d’une communauté internationale aphone, la France se contente de « saluer » la victoire d’IBK, tout en feignant de croire que « cette élection marque une étape essentielle dans la stabilisation et le redressement politique et économique du Mali ». Pas un mot sur les irrégularités. Les résultats dans certaines des régions qui échappent au contrôle de l’administration, et où IBK a réalisé ses plus gros scores grâce au soutien de groupes armés laissent pourtant songeurs nombre d’observateurs1.
DE TIMIDES AVERTISSEMENTS DE PARIS
Mal réélu, IBK change de casting ministériel, mais pas de méthodes. La situation empire dans le centre, où les massacres se multiplient. Elle stagne au nord : l’accord de paix négocié en 2015 à Alger ne connaît que de rares avancées — autant par la faute du gouvernement que par celle des mouvements armés. Et à Bamako, les scandales politico-financiers n’en finissent pas de faire les unes des journaux d’opposition. Plutôt que de remettre en cause la voie dans laquelle s’est engagé le président malien, Paris opte pour de réguliers, mais timides avertissements dans le huis clos des réunions bilatérales. Puis, convaincus qu’IBK n’est plus l’homme de la situation, l’Élysée et le Quai d’Orsay décident de tout miser sur son premier ministre. À l’époque, celui-ci se nomme Soumeylou Boubèye Maïga : cet ancien responsable des services de renseignement, qui a également dirigé les ministères de la défense et des affaires étrangères et qui occupe le devant de la scène politique depuis plus de vingt ans est bien vu à Paris, en dépit de son impopularité à Bamako, notamment en raison de son profil de « sécurocrate ».
Lorsqu’il est contraint à la démission en avril 2019 après plusieurs manifestations, la France se rapproche de son successeur, Boubou Cissé. Cet ancien cadre de la Banque mondiale a tout pour plaire à l’Élysée. Libéral convaincu, il a développé des relations de confiance avec les dirigeants français qui en ont rapidement fait leur nouveau poulain. Il leur assurait régulièrement qu’il était le seul à pouvoir se faire entendre d’IBK et à s’opposer à son clan familial. « Sans moi, ce sera à nouveau la gabegie », répétait-il aux diplomates français, qui l’ont soutenu jusqu’au bout, y compris quand sa tête était réclamée par le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), une coalition hétéroclite de partis politiques, d’organisations de la société civile, de leaders religieux et d’hommes d’affaires qui organisait des manifestations depuis plusieurs semaines pour dénoncer la corruption du régime et exiger le départ d’IBK. « Le M5 est très populaire, constate un diplomate ouest-africain en poste à Bamako. Son leader, l’imam Dicko, n’a eu de cesse ces derniers temps de pourfendre la corruption de la classe politique, et ce discours a marqué les esprits. La France n’a pas voulu voir qu’il dit ce que veulent entendre un grand nombre de Maliens ».
Et pour cause : Dicko est perçu comme le diable à Paris. Tenant d’un wahhabisme local et partisan d’un dialogue avec les djihadistes que combattent les troupes françaises, il ne mâche pas ses mots envers l’ancienne puissance coloniale, qu’il accuse régulièrement d’interférer dans les affaires du Mali. Pour la France, il est hors de question que les négociations qu’il mène avec IBK en juin et en juillet aboutissent à un accord lui donnant la part belle. « S’il voulait la tête de Boubou Cissé, c’était pour pouvoir nommer un premier ministre qui lui serait acquis », croit-on savoir à l’Élysée. Mais en soutenant le premier ministre coûte que coûte, et en poussant IBK à le conserver, la France a commis une nouvelle erreur d’appréciation. Plusieurs observateurs estiment que si un accord avait été trouvé entre le M5 et IBK, jamais les militaires n’auraient entrepris de prendre le pouvoir.
UNE VISION SÉCURITAIRE AVANT TOUT
Enfermée dans la même logique guerrière depuis sept ans en dépit des nombreux avertissements lancés par le monde de la recherche, la France s’est en outre montrée incapable de modifier sa propre approche. Même si dans les discours, les diplomates français mettent l’accent sur le développement et la bonne gouvernance, dans les faits, les questions sécuritaires restent largement prioritaires. « Aujourd’hui, au Sahel, l’aspect sécuritaire l’emporte sur tout, constatait un diplomate français l’année dernière. Les militaires sont devenus des interlocuteurs jugés essentiels par les responsables politiques. Leurs analyses priment sur les nôtres. » La mésaventure vécue par l’ancienne ambassadrice de France au Mali, Évelyne Decorps, illustre le poids grandissant des militaires dans la région : nommée en 2016, elle a été rappelée prématurément à Paris en 2018, puis envoyée dans un placard (elle est aujourd’hui administratrice des Terres australes et antarctiques françaises). Son tort : elle tenait tête aux militaires de la force Barkhane et ne partageait pas toujours leurs analyses.
« En privilégiant la sécurité sur la gouvernance, les partenaires du Mali ont négligé le fait qu’un État compétent et pourvoyeur de services est un fondement indispensable de la stabilité du pays et de la région », déplore International Crisis Group dans la note citée plus haut. « Lutter contre les djihadistes, ok, mais cela ne sert à rien si l’on ne lutte pas contre les causes qui poussent les gens vers le djihad », souligne un ancien ministre d’IBK passé à l’opposition, qui cite parmi ces causes la corruption, l’injustice ou encore la misère sociale. Cet aveuglement a abouti à une impasse, et la France, qui a fait de la lutte contre le terrorisme le curseur de son engagement au Mali ces sept dernières années, en porte une grande responsabilité.
Source: https://orientxxi.info/magazine