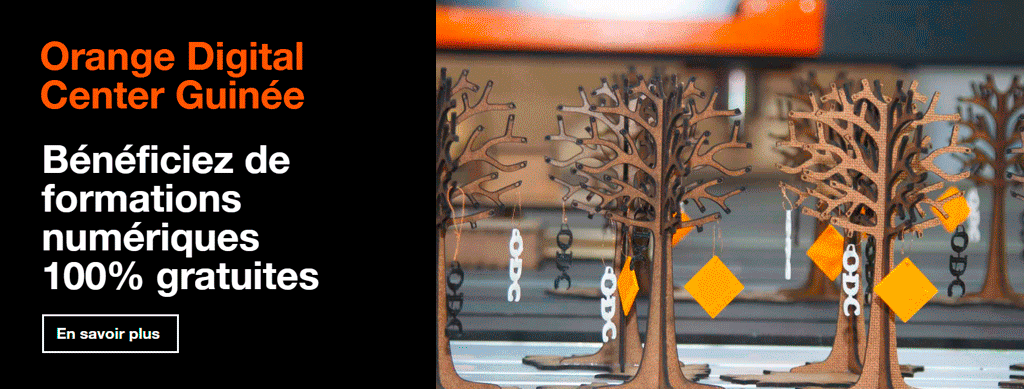Avec peu de moyens et de temps, des chercheurs burkinabés et béninois ont misé sur du vieux pour faire du neuf. Partant de la chloroquine et de l’Apivirine, ils mènent deux essais cliniques dont les résultats sont attendus d’ici deux mois.
En Europe, c’est la course au vaccin contre le COVID-19. En Amérique du Nord, tous les chercheurs et chercheuses sont mobilisé·e·s pour trouver un traitement, tandis que l’Asie annonce la réussite du premier vaccin expérimental sur des singes. Eh bien en dehors de Madagascar, qui dit avoir trouvé deux “remèdes traditionnels améliorés”, le Burkina Faso et le Bénin préfèrent miser “sur du vieux pour faire du neuf.”
Il s’agit d’un essai clinique qui devait tester la chloroquine et l’azithromycine contre le COVID et un deuxième essai clinique, qui est l’essai clinique Apivirine, qui est un phyto-médicament, qui a été mis au point par un Béninois et qui, semble-t-il, a des vertus contre le COVID. Ces deux essais cliniques, le Chloraz et l’Api-Covid-19, sont menés au Burkina Faso, qui est le pays le plus touché en Afrique de l’Ouest. C’est aussi le pays qui a enregistré le premier décès au sud du Sahara, qui compte le plus de morts après l’Afrique du Sud et le Cameroun, et qui est tiraillé entre le COVID-19 et des groupes armés.
Sous pression, les chercheurs burkinabés veulent donc trouver un médicament sûr et au plus vite. Et ils ont décidé de baser leurs études sur des médicaments qui existent déjà. Nous avons décidé de comparer parce que ce n’est pas exactement la même chose. La chloroquine phosphate ou phosphate de chloroquine, c’est un ancien médicament utilisé pour traiter le paludisme. L’hydroxychloroquine elle, est un dérivé de la chloroquine. Moins toxique, elle est notamment utilisée pour prévenir le paludisme. Quant à l’azithromycine, c’est un antibiotique utilisé pour prévenir ou traiter une infection.
Mais pourquoi ne pas simplement se contenter des conclusions chinoises et de celles du professeur Raoult ? Si les chercheurs burkinabés veulent aller plus loin, c’est parce qu’ils ne sont pas convaincus de la méthodologie utilisée. Malheureusement, le professeur Raoult n’a pas eu un bras contrôle [échantillon]. Un bras qui permet de confirmer que la chloroquine marche ou ne marche pas. Parce qu’il faut savoir que dans le COVID, 80% des patients vont guérir spontanément sans traitement. Alors lorsque vous n’avez pas de comparateur, comment vous pouvez dire à coup sûr que ceux qui sont guéris ne seraient pas guéris sans la chloroquine ? Voilà la question ! Et c’est à cette question que nous, on souhaitait répondre. Pour mener à bien leur étude, le docteur Tinto et son équipe prévoient un échantillon de 300 patient·e·s. 150 patient·e·s dans le bras hydroxychloroquine + azithromycine et 150 patient·e·s dans le bras chloroquine sulfate + azithromycine. L’idée étant de comparer les deux.
Par abus, on peut dire que c’est une étude d’équivalence mais on n’a pas la preuve réelle que l’une ou l’autre marche. Partant de ce postulat, si on a 150 par bras, cela peut nous permettre de voir quel est le meilleur des deux médicaments, des deux combinaisons. L’autre réponse que ces chercheurs africains veulent apporter concerne Ils ont remarqué que lorsqu’on utilisait la chloroquine pour traiter le paludisme, on l’utilisait à 25mg. 10mg le premier jour, 10mg le deuxième jour et 5mg le troisième jour. Ça fait quinze comprimés de 5mg. Alors, dans le cadre du COVID, il est préconisé de l’administrer à raison de 600mg par jour pendant dix jours. C’est-à-dire que vous passez de quinze comprimés à 60 comprimés. C’est énorme ! Cette forte dose serait très risquée pour les patient·e·s. C’est ce qu’explique David Juurlink, chef du service de pharmacologie clinique à l’Université de Toronto.
Ses craintes proviennent notamment de l’arrêt d’un essai clinique interrompu à Manaus dans le nord du Brésil. Réalisé sur 81 personnes, onze sont mortes en moins de six jours. La chloroquine a une toxicité cardiaque. Ça, c’est connu. Et il y a une forte accumulation de la chloroquine au niveau oculaire et peut même entraîner une atteinte de votre rétine et vous rendre aveugle si vous allez à de fortes doses. Or, ces doses de chloroquine pour traiter le palu sont pratiquement quadruplées lorsqu’il s’agit de soigner le COVID-19. C’est ce qui fait que nous, au Burkina Faso, on s’est dit, c’est bien, le gouvernement l’a introduit, mais il faut quand même qu’on mette en place un système de surveillance à travers cet essai clinique que nous sommes en train de conduire où nous allons non seulement surveiller mais nous allons également comparer cette hydroxychloroquine, qui est utilisée communément, à la chloroquine phosphate qui est moins chère et qui est plus accessible par les populations africaines.
Il s’agit donc d’un test pour voir comment la chloroquine qui existe déjà peut, sans danger, soigner le coronavirus à faible dose et en peu de temps. Si au cours de l’essai, on se rend compte qu’au bout de cinq, six jours, les patients sont soulagés, et le virus a presque disparu du sang, on pourrait par exemple faire la recommandation à notre gouvernement : “Écoutez, c’est pas la peine d’aller jusqu’à dix jours parce que on va intoxiquer inutilement les patients. Avec sept jours de traitement, notre problème peut être résolu.” Combien de temps cela prendra-t-il ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Et à quand ces recommandations ? Avec le rythme actuel des recrutements, nous pensons que si nous commençons l’essai, dans un mois maximum, on devrait quand même faire de bonnes recommandations au gouvernement du Burkina Faso. L’autre essai clinique, sera testé sur des cas graves et sur les malades simples pendant deux mois. Il s’agit d’un traitement à partir de l’Apivirine, utilisée par le chercheur béninois Valentin Agon.
Que sait-on jusqu’ici de l’Apivirine et qu’est-ce que cette plante a de prometteur ? Alors, ce que je sais de l’Apivirine, c’est que c’est un phyto-médicament qui a été utilisé depuis presque vingt ans maintenant chez les patients VIH qui l’ont pris et qui semblent dire que ça marche. Le promoteur du produit a même confirmé qu’il avait des brevets par rapport à l’utilisation de ce traitement dans la prise en charge des patients à VIH. Et je crois qu’avec le COVID, il a essayé de l’utiliser chez des patients COVID et il a été rapporté que certains patients l’ont pris et ils étaient satisfaits. Le problème, c’est qu’en science, on ne se fie pas à ce que disent les patient·e·s mais plutôt à ce que constatent les chercheurs après avoir testé le produit dans des conditions bien définies et en respectant des normes reconnues. Il s’agit d’études randomisées par exemple.
On prend deux groupes de patients, on traite l’un avec l’Apivirine, l’autre avec le médicament homologué et on les suit. Et on les compare à la fin. Du point de vue de l’efficacité, du point de vue de la durée de l’hospitalisation des patients, du point de vue de la sécurité. Et au bout de ce processus, on pourra dire si oui ou non, l’Apivirine est vraiment efficace pour prendre en charge le COVID. Mais peut-on en attendant, soigner quand même les malades avec l’Apivirine comme c’est fait actuellement avec la chloroquine ? Je pense que n’ayant pas encore fait ce processus de tests et d’essais cliniques selon ces normes que je viens de définir, il m’est difficile aujourd’hui de vous affirmer qu’effectivement c’est un traitement efficace contre le COVID.
La seule façon de pouvoir le confirmer, c’est d’aller à l’essai clinique. – Que pensez-vous de ces initiatives des chercheurs africains pour trouver leurs propres solutions au COVID-19 ? Dites-le nous en commentaires ! Contrairement à ces essais cliniques menés en Afrique par des Africain·e·s, certains laboratoires occidentaux viennent sur le continent pour y mener des tests au mépris de la sécurité des patient·e·s.